
Figure 1 : Liste d'idées issues du premier atelier




Figure 1 : Liste d'idées issues du premier atelier
Le but apparent du prototypage est la conception de l'interface utilisateur, mais en fait, c'est surtout un outil de communication. Parce qu'il aboutit à une situation particulière et concrète, il peut laisser apparaître une incohérence dans la compréhension du problème par l'informaticien ou un problème qui a été oublié ou mal défini. Ainsi, lorsque les biologistes décrivent une analyse ou une problématique particulière, il y a toujours des éléments qui sont considérés comme anodins ou des petits problèmes insolubles (un détail dans un format de fichier...) dont on ne parle pas, tellement ils sont habituels, mais qui en fait finissent par empoisonner la vie et empêcher de travailler efficacement. Ces détails aussi peuvent être découverts et rediscutés lors du prototypage.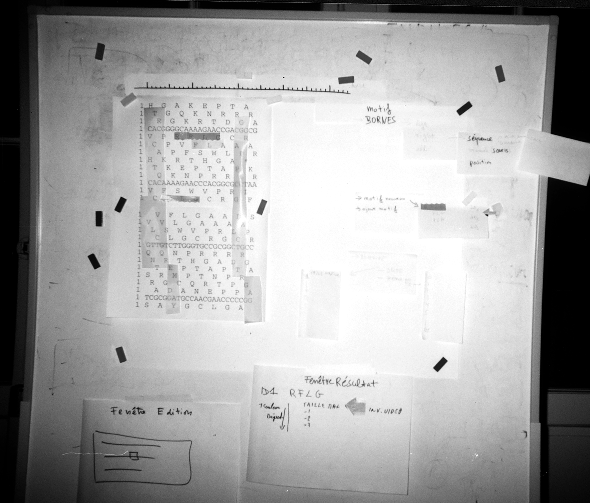
Figure 2 : Détermination d'une zone de recherche
Ces deux techniques présentent volontairement un caractère informel, concret et non informatique. Elles sont destinées à favoriser la communication et non à la formaliser, comme le font les documents de spécification informatiques ou les images écrans, qu'elles ne remplacent pas mais qu'elles complètent. Elles ont donc l'avantage de la conversation informelle, mais pas son inconvénient, qui est d'être trop abstraite, trop vague.
Figure 3 : Prototypage des annotations

 |
Édité par : Service Informatique Scientifique Institut Pasteur 28 rue du Docteur Roux 75724 Paris CEDEX 15 Tél. : +33 (1) 45 68 85 10 Fax. : +33 (1) 40 61 30 80 Câble : mcb@pasteur.fr |
Les contributions et suggestions sont à adresser à : Laurent Bloch bloch@pasteur.fr Directeur de la publication : Maxime Schwartz ISSBN : 1244-524 X Copyright © Institut Pasteur |


